Experte reconnue mondialement en néphrologie et en transplantation du rein, la Campivallensienne Marie-Josée Hébert entretient des motivations éminemment humaines dans ses travaux qui visent d’abord le mieux-être des patients.
Quand on parle de reconnaissance professionnelle, la prodigieuse carrière de Marie-Josée Hébert parle d’elle-même.
Professeure à la Faculté de médecine du CHUM, la néphrologue-chercheuse spécialisée en transplantation est titulaire de la Chaire Shire en néphrologie, transplantation et régénération rénales. Elle est l’une des fondatrices du Programme national de recherche en transplantation du Canada, qu’elle a codirigé jusqu’en 2022.
Marie-Josée Hébert a néanmoins grandi à Salaberry-de-Valleyfield, où son père œuvrait déjà dans le domaine de l’orthopédie. Elle y a fait ses cours primaire, secondaire et collégial et a par la suite été admise à l’Université de Montréal en 1984. Elle obtiendra un diplôme d’études spécialisées en néphrologie, puis complétera une formation postdoctorale du Brigham and Women’s Hospital, affilié à l’Université Harvard.
« J’ai toujours aimé fouiller et comprendre comment les choses arrivent, raconte-t-elle. J’ai été amenée me spécialiser dans les greffes rénales en constatant la joie qu’on peut procurer aux gens lorsqu’on réussit une greffe qui, dans certains cas, leur sauve la vie. »
Récipiendaire de la médaille d’excellence en recherche de la Fondation canadienne du rein, Marie-Josée Hébert se réjouit des belles histoires de vie qui découlent des expériences vécues auprès des patients et qui leur permettent d’entreprendre une nouvelle vie.
Un travail d’équipe
Les recherches menées par la spécialiste depuis le début des années 2000 répondent également à son amour pour le travail d’équipe.
Un travail des plus innovateur en néphrologie puisqu’il a permis notamment d’identifier les facteurs qui endommagent les vaisseaux sanguins et causent le rejet d’organes greffés.
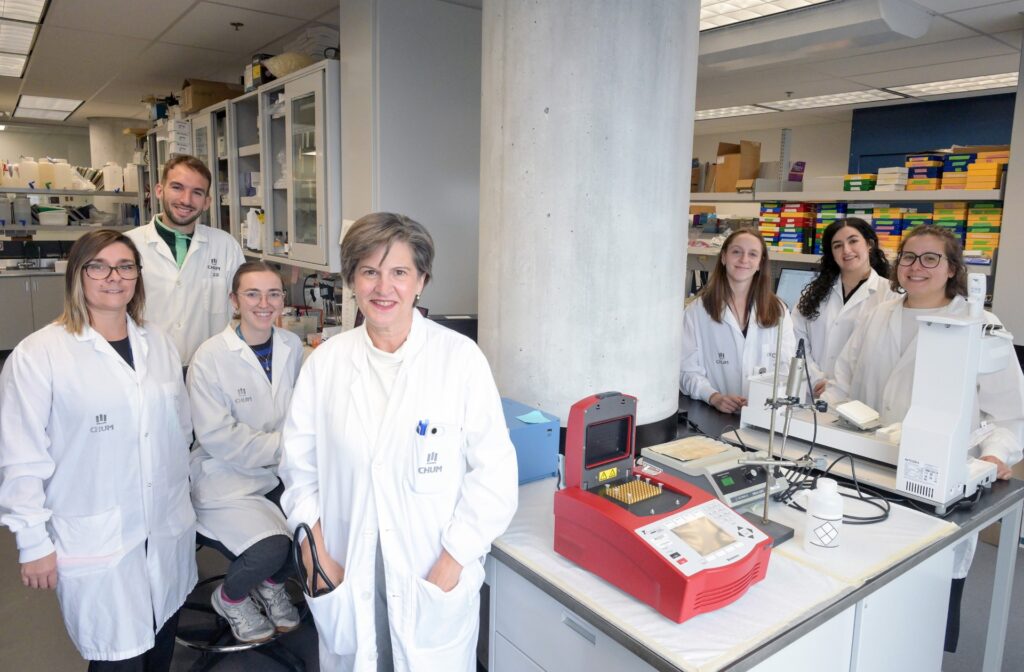
En mai dernier, ses travaux en compagnie de deux autres chercheurs ont mené à l’identification d’un marqueur sanguin prometteur pour prédire la santé microvasculaire du rein. Celui-ci appelé microARN est capable de protéger les petits vaisseaux sanguins et d’améliorer la survie des reins ayant subi de graves lésions.
On parle ici d’une avancée scientifique majeure qui pourrait avoir des répercussions en termes de prévention de cette maladie, ou encore pour des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque, d’insuffisance pulmonaire ou de certaines maladies neurodégénératives.
Présidente du conseil d’administration des Instituts de recherche en santé du Canada depuis septembre 2022, elle demeure consciente que ses recherches ont pu réussir grâce au financement dont elles ont bénéficié. « C’est ma contribution, dit-elle. Dans la vie, on ne peut pas juste recevoir, il est important de donner de son temps pour maintenir l’excellence en santé au Canada. »
Vice-rectrice à l’Université de Montréal, Marie-Josée Hébert est aussi reconnue comme une pionnière du leadership montréalais en intelligence artificielle. Ses initiatives ont abouti en 2018 en la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle.
Questionnée sur la dérive scientifique menée aux États-Unis par l’administration Trump, la chercheuse rappelle que la rigueur scientifique doit être la base de la recherche. « Quand on voit que ces principes sont mis à mal, cela suscite beaucoup d’inquiétude. La recherche scientifique n’a de sens que si elle repose sur la rigueur et n’est pas instrumentalisée à des fins politiques. »




